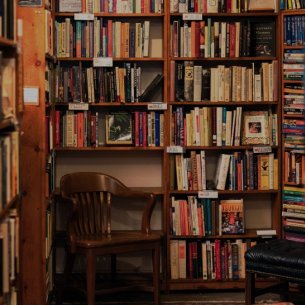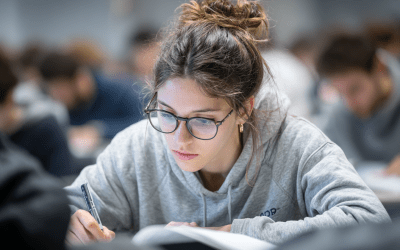1. L’analyse
Dans les énoncés des sujets, on retrouve le plus souvent le terme qui correspond au thème. La majorité des candidats ayant travaillé ce thème, il faut comprendre que ce n’est pas tant sur les connaissances relatives à ce thème que les différences s’établissent mais, au moins en partie, sur la prise en compte des autres mots qui figurent dans l’énoncé et en font la spécificité. De même, le thème n’est pas le prétexte à un étalage de connaissances, mais c’est la façon singulière dont il est présent dans l’énoncé qui doit être prise en compte, comme on a tenté de le montrer. C’est donc le nécessaire travail d’analyse qui rend possible une problématisation fidèle à ce que le sujet met en question et permet d’éviter la récitation, la juxtaposition de références et d’exemples qui ne prennent pas suffisamment en compte le problème à traiter. En d’autres termes, il convient de se demander d’abord non pas “que vais-je répondre ?”, mais “qu’est-ce qu’on me demande ?”. Mais ce travail n’est pas qu’un simple préalable dont on pourrait s’acquitter au début, par une simple définition, pour ne plus y revenir : il doit se poursuivre tout au long du développement, et c’est ainsi que se concrétisent la progression et l’approfondissement de la réflexion.
2. La problématisation
Problématiser un sujet ne se limite pas à opposer brutalement deux affirmations contradictoires. C’est au contraire mettre en évidence une hésitation de la pensée devant des difficultés. C’est pourquoi une dissertation doit être animée par une pensée soucieuse et questionnante, dont le mouvement s’explicite à travers des transitions qui ne sont pas des artifices rhétoriques, mais l’expression même du progrès de la réflexion, où l’interrogation doit avoir toute sa place.
3. Plan et transitions
La présentation du plan dans l’introduction ne doit pas avoir pour effet de “tuer” le problème. C’est pourtant ce qui se passe lorsqu’on énumère les grandes affirmations qui vont scander le développement comme autant de points d’un exposé. Il est préférable de mettre en avant des objets de questionnement plutôt que des propositions dogmatiques : “nous nous demanderons pourquoi”… est ainsi préférable à “nous verrons que”. Il en va de l’esprit même de la dissertation.
4. Conventions de présentation
Il est inutile de numéroter les parties et les sous-parties du développement. De même, il n’y a pas lieu de faire figurer des titres, qui brisent la continuité de la réflexion, telle qu’elle s’exprime dans les transitions. Une écriture soignée et lisible, sans ratures, est appréciée : elle marque autant le souci d’être compris que le respect du lecteur.
5. Orthographe
A la différence de l’épreuve de résumé, il n’y a pas de barème spécifique prévoyant le retrait de points en fonction du nombre de fautes. Toutefois, le souci de l’orthographe, ainsi que de la syntaxe, est nécessaire, car les deux jouent un rôle dans l’appréciation globale de la copie. Dans cette perspective une relecture spécifique et attentive est indispensable.
6. Le sujet hors thème.
Il faut rappeler ici que le choix de ce sujet doit être fait pour des raisons positives. Celui-ci ne saurait en effet servir de remède à une préparation insuffisantedurant l’année, d’autant que son traitement implique de mobiliser des capacités équivalentes à celui du premier, et de prendre appui sur la maîtrise du programme de première année, qui doit donner les moyens d’un traitement argumenté.
Terminons en souhaitant que les candidats trouvent dans ces lignes des raisons de croire que, plutôt qu’un bachotage aveugle, une préparation méthodique et réfléchie est la condition non seulement d’une épreuve réussie, mais aussi de la formation du jugement éclairé nécessaire à chacun, bien au-delà du concours.
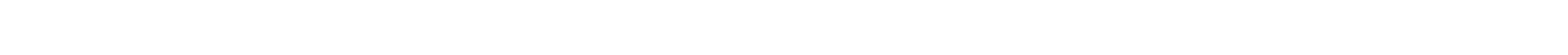
![]() À la une
À la une